Colloques et journées d’étude
-
« Documentaire et archives : problématiques croisées »
Dans la continuité de son colloque anniversaire « Archives et cinéma », l’association Kinétraces organise un colloque consacré aux rapports entre un genre cinématographique, le documentaire, et l’archive, comprise à la fois comme document (objet de forme variée, matérielle ou non), source (support de l’analyse historique) et trace (empreinte du réel). Nous souhaitons porter la réflexion sur l’articulation entre ces deux sujets distincts à bien des égards, mais dont les problématiques peuvent présenter des affinités. Les relations plurielles entre le documentaire et l’archive sont, au fond, de nature dialectique : les problématiques de l’un et l’autre s’éclairent réciproquement. Mardi 10 et mercredi 11 juin 2025, à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (salle Athéna, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris).
Le programme est disponible ci-dessous

Mardi 10 juin
9h – Accueil des participantes et des participants
9h30 – Introduction par le comité d’organisation
9h30-10h45
LE CINÉMA DOCUMENTAIRE : QUELLE VÉRITÉ ?
Stéphane Pichelin (Université de Rennes 2, APP), Cinéma et archives : la non-évidence de la fonction documentaire. Retour sur une recherche.
Adrien-Gabriel Bouché (Université de Rennes 2, APP), Des archives familiales, vraiment ? Le mystère Gérard Fleury ou la grande manipulation de José Luis Guerin.
10h45-11h Pause-café
11h-12h15
DOCUMENTER LES OUBLIÉS DES ÉTATS-UNIS
Luana Thomas (Université de Lille, CEAC), Archiver et travailler la mémoire : les documents préparatoires de Sud de Chantal Akerman.
Antoine Nséké Missé (EHESS, Mondes Américains, CENA), Lost in Interaction? Utiliser Welfare de Frederick Wiseman comme archive pour écrire une histoire de l’Assistance sociale aux Etats-Unis.
12h15-14h Déjeuner
14h-15h15
CINÉMA DOCUMENTAIRE ET ARCHIVES INSTITUTIONNELLES
Elias Cantone (Sciences Po Paris), Les archives de l’Unitelefilm (1963-1981). La diffusion d’une « activité critique », entre coercition du PCI et agentivité des cinéastes.
Sandrine Gill (Archives nationales), Les documentaires de la cinémathèque de l’Agriculture : de la commande institutionnelle à l’expression d’un point de vue.
15h15-15h30 Pause-café
15h30-16h45
DOCUMENTAIRE, ARCHIVES ET COLONIALISME FRANÇAIS
Floriane Germain et Elodie Larchevêque (ECPAD), La guerre d’Indochine : regards croisés sur deux documentaires historiques.
Jean Valentin (Université Paris Cité, CERILAC), Supports et mémoire: étude des matériaux filmiques et écriture de l’histoire des documentaires de propagande coloniale sur l’Indochine.
18h
PROJECTION
Patria Obscura (2014) de Stéphane Ragot au cinéma Saint-André des Arts, en association avec Le Maghreb des Films.
Mercredi 11 juin
9h15 – Accueil des participantes et participants
9h30-10h45
SE RÉAPPROPRIER LES ARCHIVES COLONIALES : DÉMARCHE CRITIQUE
Ana Catarina Pinho (Nouvelle université de Lisbonne, IHA), Excavating the archive. Documentary and the Politics of Memory in Postcolonial Portugal.
Clara Bastos (Université de São Paulo), Cuatreros (2016, Albertina Carri) : mémoire lacunaire et expérience subjective traversée par le genre.
10h45-11h Pause-café
11h-12h15
LES ARCHIVES PARALLÈLES : DOCUMENTER CE QUE LA DICTATURE EFFACE
Anna Dodier (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, LLA-CREATIS), Mouvements arrêtés : l’archive photographique dans deux documentaires sur la dictature militaire chilienne (La ciudad de los fotógrafos de Santiago Moreno et Mi vida con Carlos de German Berger-Hertz).
Eve Le Fessant Coussonneau (Université de Poitiers, FoReLLIS), Remonter pour désarchiver : VlopCinema et la réappropriation des archives chiliennes à l’occasion des cinquante ans du Coup d’Etat.
12h15-14h Déjeuner
14h-15h15
PAROLES ARCHIVÉES
Vincent Jacques (ENSA Versailles), Ecouter et restituer les fantômes du colonialisme : les archives anthropologiques sonores dans The Halfmoon Files de Philip Scheffner.
Thomas Pillard (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV), Récuser témoins et documents « officiels », un gage de vérité ? La Guerre sans nom (Tavernier et Rotman, 1992) : la parole et les photographies des appelés d’Algérie à l’épreuve des (autres) archives.
15h15-15h30 Pause-café
15h30-16h30
L’ARCHIVE DANS LA CRÉATION DOCUMENTAIRE
Olivier Azam (Réalisateur, Les Mutins de Pangée), Autour du montage du film en cours Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, l’usage des archives filmées américaines dans un contexte de purge DEI et de grand effacement par Donald Trump.
Claire Duguet (Réalisatrice), Documenter le travail de cinéastes.
Stéphane Ragot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA), Invention et mise en scène de l’archive non-filmique dans le cinéma documentaire : l’exemple de Patria obscura (2014, 1h23).
17h30 Mot de clotûre des organisateurs
-
« Archives et cinéma : actualité, évolutions, enjeux » Pour célébrer son dixième anniversaire, l’association Kinétraces propose un colloque de recher- che d’ampleur autour de l’archive, son objet, et du patrimoine cinématographique, son domaine. À cette occasion, la réflexion se concentrera autour de la notion d’archive et de son statut dans la recherche cinématographique, dans l’optique de saisir les évolutions manifestes de la pratique archivistique. 23-24 novembre 2023
dans la salle Claude Simon de la Maison de la Recherche
4 rue des Irlandais (75005, Paris)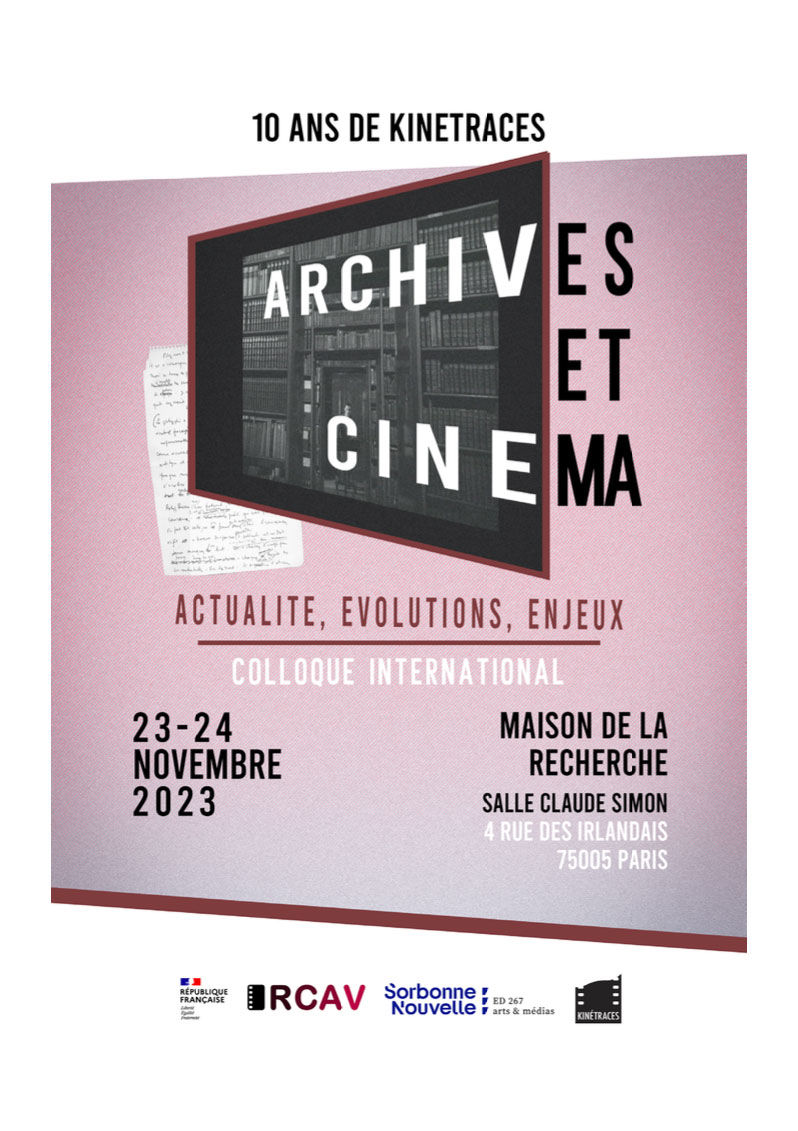
Jeudi 23
9h30 – Introduction par le comité d’organisation
CONFERENCE D’OUVERTURE
9h45-10h30 – Valorisation ludique d’un fonds : les « Papiers Alain Resnais » sur le site de l’Imec, François Thomas (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)
Modération : Matthieu Couteau
10h30-10h45 Pause-café
PRATIQUES DE L’ARCHIVE
10h45-11h05 – La provenance comme outil révélateur dans la recherche en archive, Clara Auclair (chercheuse indépendante)
11h05-11h25 – Atouts et faiblesses de l’archive numérique, Simon Rozel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA)
11h25-11h45 – Intelligence artificielle dans les archives : une possibilité pour (ré)écrire l’histoire du cinéma ?,
Beatriz Tadeo Fuica (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)Modération : José Moure
12h Déjeuner
DES ARCHIVES AU FILM
13h30-15h30 – Table ronde en présence de Céline Gailleurd (Italia, le feu, la cendre, 2022), de Raquel Schefer (Nshajo (O Jogo), 2011), de Noah Teichner (Navigators, 2022) et d’Eléonore Weber (Il n’y aura plus de nuit, 2021)
Modération : Laurent Husson
15h30-16h00 Pause-café
KINÉTRACES A DIX ANS
16h00-17h30 – Table ronde en présence d’Arthur Côme, de Jitka de Préval, de Laurent Husson, de Nadège Mariotti et de Marién Gómez Rodriguez
Modération : Laurent Véray
17h30 Cocktail de festivités
Vendredi 24
9h30 – Accueil des participantes et participants
DES ARCHIVES À LA VALORISATION
9h45-11h15 – Table-ronde en présence de Christophe Dupin (FIAF), de Julie Guillaumot (BnF), de Géraldine Poels (INA) et de Véronique Rossignol (Cinémathèque française)
Modération : Laurent Guido
11h15-11h30 Pause-café
METHODOLOGIE DE L’ARCHIVE
11h30-11h50 – Le gouffre de l’archive. Travailler sur un fonds non inventorié : le cas des archives de Chantal Akerman, Luana Thomas (Université de Lille, CEAC)
11h50-12h10 – Fragilité du patrimoine cinématographique de l’ONU, Suzanne Langlois (Collège universitaire Glendon, Université York de Toronto)
Modération : Marién Gómez Rodriguez
12h20 Déjeuner
POLITIQUE DE L’ARCHIVE
14h00-14h20 – L’impact de la restauration des archives cinématographiques sur l’histoire du cinéma iranien, Gita Aslani Shahrestani (Université Paris Nanterre, HAR)
14h20-14h40 – Les archives numériques des films amateurs coloniaux et la question de la décolonisation, Guglielmo Scafirimuto (Université Toulouse-Jean Jaurès)
14h40-15h – De la parole empêchée aux documents douteux, quand l’archive invite à la prudence, Garance Fromont (Université Paris Cité, CERILAC)
Modération : Beatriz Tadeo Fuica
15h15-15h30 Pause-café
DES ARCHIVES À LA RECHERCHE
15h30-17h00 – Table ronde en présence de Frédérique Berthet (Archi-Vives) et de Stéphanie Louis (CinEx)
Modération : Marie Frappat
17h00 Conclusion du colloque par le comité d’organisation
-
« Quand montrer c’est faire : performer la séance »À l’INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris),Auditorium et salle Warburg,les 11 et 12 décembre 2018.

« Il n’a d’autre référent que sa profération : c’est un performatif », énonce Roland Barthes pour définir le discours amoureux dans ses célèbres Fragments.
La séance cinématographique peut, elle aussi, s’envisager sous l’angle de la performance : le film étant projeté, « agi », activé, par la tenue de la séance. Faire de la séance de cinéma un acte, penser ce qui fonde l’expérience cinématographique, voilà ce qui motive la tenue de ce colloque. La notion de séance requiert en effet une attention renouvelée, suivant les évolutions esthétiques, technologiques et sociales qui touchent au médium filmique et à ses modalités de monstration. Ces deux journées d’études et de projections, en présence de chercheurs, programmateurs, archivistes et artistes invitent à penser l’archéologie et les formes de la séance cinématographique en tant qu’acte performatif.Engagé en 2017, le projet Séance(s) porté par l’association Kinétraces articule un ensemble de manifestations scientifiques et de valorisation autour de la notion de séance de cinéma (journée d’études, séminaire, publications, projections) – avec le soutien de la Maison de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, du laboratoire CERILAC et de l’Ecole Doctorale 131 de l’Université Paris Diderot – Paris 7 et du laboratoire ESTCA de l’Université Paris 8. -
JOURNÉE D’ÉTUDES : SÉANCES DES ANNÉES FOLLES « Séances des années folles. Salles, pratiques, techniques » Une journée d’études conçue par l’association Kinétraces autour de la notion de séances cinématographique et théâtrale dans la France des années 1920. Vendredi 2 juin 2017
dans les locaux du CNC
32 rue Galilée (75016, Paris)
et 12 rue de Lübeck (75016, Paris)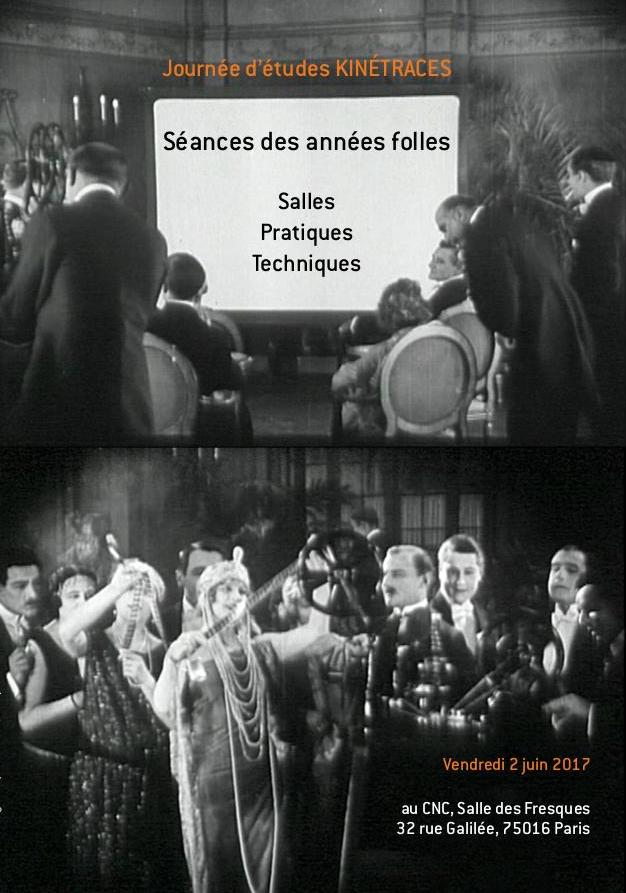
Au programme :
9h : accueil des participants au CNC, 32 rue Galilée (75016, Paris)
9h30 : présentation du projet « Séance » et de la journée d’études par Manon Billaut, Emmanuelle Champomier, Agnès Curel, Céline Pluquet, et Élodie Tamayo
PANEL 1 / LES SALLES
10h : Ouverture du panel par le président de séance : Laurent Véray (Université Paris 3)
10h10 : Jean-Jacques Meusy (CNRS) : « Évolution de la séance de cinéma, des origines aux années 1920 »
10h40 : Shahram Abadie (Ensa Clermont-Ferrand) : « Le cinéma sur la scène architecturale et urbaine. Les salles parisiennes des « Années folles » »
11h10-11h30 : Pause
11h30 : Christophe Gauthier (École nationale des Chartes) et Marco Consolini (Université Paris 3) : « Le Vieux-Colombier, un espace de culture théâtral et cinématographique »
12h10 : Annie Fee (University College London) : « Aller au cinéma à Paris pendant les années 1920 : une approche spatiale de l’histoire des salles de cinéma »
12h40 : Questions
Déjeuner
PANEL 2 / LES PRATIQUES
14h30 : Ouverture du panel par le président de séance : Laurent Guido (Université Lille 3)
14h40 : Marylin Marignan (Université Lyon 2) : « Unicité de la séance : de l’accompagnement musical aux intermèdes »
15h10 : Charlotte Servel (Université Paris 7) : « Les salles obscures des surréalistes »
15h40 : Questions
16h-16h20 : Pause
PANEL 3 / LES TECHNIQUES
16h20 : Ouverture du panel par le président de séance : Patrick de Haas (Université Paris 1)
16h30 : Cristina Grazioli (Università di Padova) : « Espaces partagés : les relations entre lumière, projection, espace. Réflexions et expérimentations (1910-1930) »
17h : Enrico Camporesi (Labx CAP, CRAL, EHESS) : « La séance et l’atelier – notes à partir de la soirée Dada du Cœur à barbe »
17h30 : Questions
——-
Soirée de projection précédée d’un buffet au 12 rue de Lübeck, 75016, Paris.
19h40 : Présentation de « La Tierra de los torros » (Musidora, 1924) par Marién Gómez Rodríguez.
20h : Projection du film, avec reconstitution des intermèdes chantés et dansés (100’).
Interprète : Marie-Claude Cherqui
Accompagnement musical au piano : Adelon Nisi, élève de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)
Accompagnement musical à l’accordéon : Michel Viennot
Projection 35 mm, copie en provenance des AFF/CNC (nos remerciements à l’association des Amis de Musidora).Entrée libre
-
COLLOQUE KINÉTRACES 2016 – DE L’ARCHIVE AU FILM, DU FILM À L’ARCHIVE

Dans la recherche cinématographique envisagée dans une perspective historique, l’archive (filme et non-film) est une source fondamentale. La notion d' »archive » désigne tout document, quels que soient sa forme et son support matériel, contenant des traces du passé permettant aujourd’hui de le documenter, de l’appréhender et d’en connaître certains aspects. L’archive devient ainsi un support matériel mais aussi un réservoir du « temps passé », qui acquiert une dimension historique et mémorielle dans le temps.
Le colloque De l’Archive au Film, du Film à l’Archive se propose ainsi de questionner l’historicité, la narrativité et la plasticité de l’archive de cinéma.
Adresse:
Institut du Monde Anglophone
5, rue de l’Ecole de Médecine
75006 – Paris
Métro: Odéon ou Cluny la Sorbonne
Entrée libre
Merci à tous les participants et à tous ceux qui ont assisté au colloque !
-
Colloque international sur le caractère éphémère du support et de l’art filmiques
6–7 mai 2015 à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
« Les meilleurs films sont ceux qu’on n’a pas vus. »
—Bernard Eisenschitz1
Avec la généralisation de l’outil numérique au sein de l’industrie cinématographique se pose plus que jamais la question du devenir des films. Les professionnels de la restauration de films, les chercheurs et les archivistes du monde entier ne cessent de démontrer depuis plusieurs années, à l’occasion de colloques, de journées d’étude ou de festivals, que le numérique n’est pas une solution en soi et qu’il entraîne des problèmes d’une complexité inégalée. La promesse d’une « libération matérielle » du médium cinématographique demeure utopique, et les questions de la conservation et de la diffusion des films se font elles plus profondes encore.
Malgré ces avancées techniques, le cinéma reste un art fondamentalement précaire. En raison de la fragilité des supports, qu’ils soient photochimiques ou numériques, les œuvres filmiques peuvent disparaître à tout moment. La « mort des films » ne résulte pas seulement de la disparition des copies, mais aussi de leur altération, et du bouleversement irrémédiable que celle-ci entraîne sur leur contenu et ses possibles interprétations. Films perdus dont ne sont conservés que des projets écrits ou des articles dans des journaux ; films incomplets, décomposés par le temps, ou mutilés lors de leur exploitation ; films inachevés ; films restés à l’état de projets ; ou encore films fantômes, projetés une seule fois devant un public restreint… Ces « films morts » font partie intégrante de l’histoire du cinéma.
En l’absence des matériaux d’origine et de copies, les oeuvres s’incarnent dans des archives films (repérages, rushes, chutes…) et non-film (sources iconographiques, écrites, orales, collections d’appareils et d’accessoires). Les films morts nous renseignent sur la façon de conserver les oeuvres encore en vie, sur des décisions artistiques, économiques, politiques prises lors du développement d’un projet cinématographique… Ils sont parfois même plus instructifs que les œuvres dont l’intégrité a été (supposément) préservée. Alors que la préservation pérenne des copies reste aléatoire, comment faire revivre une œuvre disparue ? Et quel est le statut des « films morts » dans la recherche en cinéma et audiovisuel ?
L’altération – voire la disparition – de nombreuses copies passe même parfois inaperçue. La question de la valeur de la copie que nous regardons est donc fondamentale. Elle prend d’autant plus d’ampleur avec l’usage du numérique : la pléthore de normes matérielles et éthiques suscite des usages extrêmement divers, à tel point qu’il semble impossible, malgré le mythe créé par des discours publicitaires omniprésents, de parler de « version définitive » d’un film. Comment doit-on considérer la question de la copie, et donc de la version, que nous, spectateurs, regardons ?
La « mort » des films doit donc être aujourd’hui pensée au regard des questions qu’elle pose à l’historiographie du cinéma. Si la fragilité des œuvres doit absolument être prise en compte, doit-on dès lors repenser le cinéma comme un « art vivant » ?
Pour débattre de ce sujet, nous sommes heureux d’inviter chercheurs, professionnels et doctorants à venir présenter des exemples représentatifs et contribuer à une réflexion théorique générale sur l’écriture de l’histoire du cinéma et la conservation des films.
1. Jacques Aumont (dir.), Pour un cinéma comparé : influences et répétitions, Paris, Cinémathèque française, 1996.
-
PAGE EN CONSTRUCTION

